| Accueil · Public-privé · Catastrophe de Pécrot : la SNCB condamnée Catastrophe de Pécrot : la SNCB condamnéeC'est la première fois qu'une
entreprise publique est condamnée pénalement en Belgique. La SNCB a été jugée
responsable de l'accident de Pécrot, qui a fait huit morts en 2001.
L'administrateur délégué Vinck affirme que la sécurité est renforcée
depuis cette catastrophe. Sûr?
99.157 euros. C'est le montant de l'amende à laquelle la
SNCB a été condamnée par le tribunal de police de Wavre, ce 15 septembre,
pour sa responsabilité dans l'accident de Pécrot. Le juge a retenu plusieurs
éléments de culpabilité: manque de formation du personnel intervenu dans le
drame (conducteur, signaleur, sous-chef de gare, responsable de ligne, répartiteur
électrique), mauvais emplacement de la plaque d'arrêt en gare de Wavre,
absence de balise pour arrêter automatiquement les trains brûlant les feux
rouges, absence de moyens de communication pour joindre les conducteurs.
Depuis la loi du 4 mai 1999, les personnes morales peuvent être
poursuivies au pénal. D'où cette amende, que la SNCB ne doit pas payer
l'amende si, dans les trois ans, elle investit une somme équivalente dans la sécurité.
Mais ce n'est évidemment pas quelque 100.000 euros ni même les 240.000
euros maximum auxquels elle pouvait être condamnée selon la loi qui peuvent
peser dans une réelle politique de sécurité.
«Nous n'avons pas attendu ce jugement pour tirer les leçons
de la catastrophe, a réagi Karel Vinck, administrateur délégué de la
SNCB. Nous avons revu l'organisation de la sécurité et fait de gros
investissements en la matière.» Mais lorsqu'il s'agit de donner un élément
concret, Vinck se contente de parler au futur: «Une de nos priorités est de
créer un centre de formation permanent pour notre personnel.»
Il est vrai que la sécurité est une ambition affichée de
la direction. Seulement, cela ressemble fort à la politique de la
multinationale sidérurgique Arcelor à Cockerill Sambre: d'une part, on harcèle
les ouvriers pour qu'ils portent un casque en permanence, de l'autre, les
objectifs de rendement y ont tué plus de vingt travailleurs depuis la
privatisation, en 1998. Alors que les cinq années précédentes, il n'y avait
pas eu un seul accident mortel.
La SNCB a publié une brochure Objectif sécurité qui
se veut rassurante. On y lit par exemple que la formation des conducteurs est de
56 semaines, soit un peu moins de 14 mois. Mais pourquoi n'est-elle plus de 18
mois comme dans les années 90?
Et à quoi bon une telle formation si, comme on l'évoque
dans le plan de restructuration New Cargo, les trains marchandises
pourraient bientôt être conduits non plus par les conducteurs mais par des
conducteurs de manoeuvres, moins formés et moins... payés?
De même, la brochure relève très justement que la sécurité
est intimement liée aux tâches du sous-chef de gare et de l'accompagnateur de
train. Mais la SNCB est occupée à supprimer les gares jugées non rentables
et forcément les sous-chefs qui y travaillent. Quant aux accompagnateurs,
certains plans ont été jusqu'à évoquer l'idée de faire rouler les trains
sans eux sur les lignes régionales.
La brochure indique encore qu'«une inspection et un
entretien constants des voies contribuent également à un haut niveau de sécurité
du trafic ferroviaire.» Or, un conducteur nous confiait, dans notre dernière
édition,que par manque de personnel pour retirer les feuillages et broussailles
le long des voies, des dizaines de panneaux de signalisation ne sont plus
visibles ces deux derniers mois.
En clair, on ne peut garantir la sécurité avec une
politique qui vise avant tout le profit, dans le cadre de la libéralisation
européenne. Et on ne peut pas faire confiance aux deux principaux conducteurs
belges de cette politique Vinck, patron issu du privé et le ministre libéralisateur
Vande Lanotte pour assurer la sécurité.
C'est pourquoi une réforme démocratique de la SNCB
s'impose, qui accorderait un pouvoir réel aux premiers concernés par la sécurité
: les usagers et les cheminots. Par exemple, au travers de comités de sécurité
qui auraient le pouvoir de dénoncer des situations anormales et d'imposer les
changements pour y remédier.
Huit vies qu'on aurait sans doute pu
épargner
Deux trains se percutent de plein fouet
à Pécrot (entre Wavre et Louvain), le 27 mars 2001. Bilan très lourd: huit
morts, douze blessés. Les photos en attestent: le choc a été d'une
violence inouïe. Pourquoi les trains circulaient-ils sur la même voie et
pourquoi n'a-t-on pu les arrêter ? Deux ans et demi plus
tard, la SNCB se trouve sur le banc des accusés. Elle tente de charger l'un des
conducteurs, décédé, mais la responsabilité de l'entreprise publique semble
manifeste. Parquet et parties civiles accusent celle-ci de ne pas prendre toutes
les mesures pour assurer la sécurité des voyageurs. Voici le fil des événements...
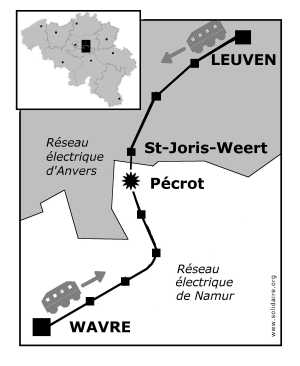
Un train vide se trouve en gare de Wavre, le 27 mars 2001.
Aux commandes: Koen Heylighem, 31 ans, entré à la SNCB en août 1999. Le feu
est rouge, pourtant le conducteur démarre. En effet, il ne peut pas voir ce feu
car la cabine du train se trouve cinq mètres devant, à hauteur de la
plaque-repère qui indique normalement le lieu d'arrêt le plus favorable
en fonction du nombre de voitures. Les conducteurs habituels de la ligne savent
qu'ils ne doivent pas tenir compte de cette plaque, mais le machiniste n'en est
pas.
S'il ne quitte pas sa cabine pour vérifier le feu, c'est
sans doute parce que le passage à niveau lui faisant face se ferme et qu'il
l'interprète comme une ouverture du passage pour son train. Or, si les barrières
se baissent, c'est pour laisser passer un convoi de marchandises. Ce
franchissement de feu n'est pas exceptionnel. Les trois années précédentes,
un rapport alarmait les administrateurs de la SNCB de l'augmentation de leur
nombre: moins de 40 en 1998, 45 en 1999, 59 en 2000.
Le train vide part donc vers Louvain, mais sur la mauvaise
voie, car l'aiguillage n'a pas été actionné par le signaleur de Wavre.
Celui-ci constate l'anomalie, mais entre Wavre et Sint-Joris-Weert, il n'y a pas
d'autre aiguillage pour remettre le train du bon côté. On prend contact avec
Bruxelles et Louvain, afin de ne pas laisser partir le train qui va de Louvain
à Wavre. Ou pour l'immobiliser en coupant le courant. Mais à Bruxelles, on
croit pouvoir le couper sur toute la ligne à partir d'Anvers. Or, au sud de
Sint-Joris-Weert, l'électricité est contrôlée depuis Namur.
Les cheminots de Wavre et Louvain ne se comprennent pas
problèmes linguistiques et Namur n'est pas prévenu. Quand Anvers fait couper
la tension, il est déjà trop tard: le train L6458, qui vient de Louvain et
transporte 24 passagers, a déjà dépassé Sint-Joris-Weert. Les deux trains se
percutent à Pécrot. L'accident fait douze blessés et huit morts: les deux
conducteurs ainsi que l'accompagnatrice et cinq voyageurs du train L6458. L'un
d'eux avait 14 ans...
Le 3 décembre 2003, la première audience du procès Pécrot
s'ouvre à Wavre, au Tribunal de police. Le parquet, représenté par la
substitute Ariane Lambrights, dépose un dossier de quelque 1.100 pages contre
la SNCB: les sociétés peuvent en effet être poursuivies sur le plan pénal.
Au cours du procès, la magistrate accusera plusieurs fois l'entreprise publique
de ne pas prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des voyageurs.
Et un des avocats au procès va détailler six fautes de la
SNCB: plaque repère mal placée en gare de Wavre; absence de dispositif pour
arrêter un train franchissant un signal d'arrêt; absence d'un dispositif radio
sol-train; contradictions dans la réglementation imposée au conducteur d'un
train qui franchit un passage à niveau ouvert; déficience des moyens de
communication interne; lacunes dans la formation du personnel.
Ce 15 septembre, le juge prendra-t-il en compte cette cascade
d'éléments qui mettent en question la politique de la société «morale» ?
Ou retiendra-t-il la thèse de la SNCB la faute au conducteur et à pas de
chance?
Michaël, le miraculé
Michaël Darche est un miraculé. Ce jeune était en tête du
train L6458 lors de l'accident de Pécrot. «Il lui reste des séquelles,
mais il a eu beaucoup de chance», confie son père, qui s'est constitué
partie civile contre la SNCB.
Quand il sort du coma, après un mois, Michaël Darche n'a
plus le moindre souvenir des faits. On lui raconte l'accident, il a de la peine
à y croire. Il a treize ans et demi lorsqu'il embarque dans la première
voiture du train qui va entrer en collision frontale avec un autre à Pécrot.
Oui, cette voiture que les ahurissants clichés de l'accident montrent surélevée
dans les airs. «Les pompiers nous ont montrés sur une photo par où l'on a
sorti Michaël. C'est invraisemblable...», explique son père, Olivier
Darche.
Le jeune souffre d'un traumatisme crânien, d'une triple
fracture au bassin, de fractures au pied droit, à la clavicule, aux côtes...
Il va passer un mois aux soins intensifs, trois gros mois à l'hôpital, un an
en revalidation. «Il lui reste des séquelles, mais il a eu beaucoup de
chance, confie son paternel. Au début, il ne savait pas marcher.
Maintenant, ça va, mais il ne pourra plus jamais courir.»
Après l'accident, les parents de Michaël ne reçoivent pas
le moindre contact de la part de la SNCB. «Pas une lettre, pas un coup de
fil. Evidemment, au début, on ne pense pas à ça. Après une telle
catastrophe, on est esseulé. On vit sa peine de son côté. Mais au bout de
trois semaines, ma décision était prise: c'est sûr, j'attaquerais la SNCB en
justice.»
Olivier Darche prend donc un avocat les familles des
victimes ne se sont pas groupées pour agir collectivement et se constitue
partie civile dans le procès qui débute en décembre 2003. Il a été à deux
audiences, qu'il a trouvées indigestes. «On tergiverse à n'en plus finir
sur des articles de loi. Pour moi, c'était une perte de temps d'y aller.»
En l'attente du verdict, il a une certitude: l'accident est dû
à une conjonction d'éléments dont la société de chemin de fer est
responsable. «La SNCB veut surtout charger le conducteur (qui est décédé).
Il a sa part de responsabilité, mais tout lui mettre sur le dos, c'est trop
facile. Si on analyse un peu, on voit que cela a foiré à tous les niveaux.
Certains ne savaient même pas qu'il y a avait deux tronçons alimentés en électricité
l'un par Anvers, l'autre par Namur. A Bruxelles, c'était le patinage
artistique, à Anvers patinage, à Louvain patinage, à Wavre patinage. Et à
Namur, ils n'ont pas été prévenus. Ils ont tous été incapables d'arrêter
ce fichu train. Lors de la simulation effectuée plus tard, il n'a fallu que
deux minutes pour l'immobiliser.»
La responsabilité de la SNCB, le papa de Michaël en prend
encore pour preuve les changements effectués peu après le drame: «Deux
jours plus tard, le panneau repère en gare de Wavre a été déplacé. Après
deux mois, un système sol-train, qui permet de prévenir le conducteur, a été
installé sur la ligne.» Ayant discuté avec des cheminots, il pointe également
la réduction du temps de formation des conducteurs de train. «La
signalisation des chemins de fer, c'est autre chose que sur route. Avant, ils
avaient deux ans de formation et des tâches progressives, d'abord sans
voyageurs. Actuellement, ils sont formés de plus en plus vite.»
A-t-on tiré les leçons de Pécrot
?
Risque-t-on de vivre un Pécrot bis? Les cheminots que nous
avons contactés en sont convaincus. L'un d'eux raconte même qu'on a frôlé un
accident du même genre en janvier: «Un train a franchi un signal au rouge
à Etterbeek et a continué sa route par la ligne 26 (qui vers Hal et croise la
ligne 124 Bruxelles-Charleroi à Linkebeek). Or, à Linkebeek. un train
marchandises s'apprêtait à partir sur la ligne 124 pour prendre la ligne 26 en
sens inverse (direction Etterbeek). Ni Etterbeek ni le dispatching n'ont pu
contacter le conducteur. Ce dernier a continué sa route jusqu'à la bifurcation
de Linkebeek sans que le courant ne soit coupé sur la ligne 26 et sans qu'on
n'ait pu le contacter par GSM.»
La Belgique était naguère au top en matière de sécurité
ferroviaire. Mais depuis les années 80, la situation se dégrade. En cause? «Cela
fait des années que la SNCB applique une politique de réduction des coûts, en
raison des impératifs budgétaires imposés par les gouvernements successifs, explique
un délégué. Et aujourd'hui, avec la libéralisation européenne du rail,
dont le gouvernement est coresponsable, cette politique s'aggrave.»
Ses conséquences sur la sécurité sont de trois ordres: il
y a le manque d'investissement dans le matériel, un manque de formation du
personnel et les plans de réduction des effectifs.
Manque d'investissement dans le matériel
«On ne peut pas exclure le risque d'erreurs humaines, explique
un conducteur de train. Mais il existe des moyens techniques pour limiter
leurs effets. Par exemple, le TBL2. Il s'agit d'une balise freinant
automatiquement les trains aux feux rouges. Avec un tel système, le drame de Pécrot
aurait été évité. Mais seules les lignes TGV en sont équipées.» Car,
comme l'explique un responsable syndical, «on parle de ces balises depuis
les années 80, mais elles n'ont jamais été placées car jugées trop onéreuses.»
Dans le catalogue des décideurs, les vies humaines ont manifestement une cote
moins élevée que ces balises...
Autre manquement fatal de Pécrot: l'absence de moyen de
communication avec les conducteurs des trains. Aujourd'hui encore, certaines
lignes importantes du trafic marchandises comme la ligne 90
Denderleuw-Ath-Jurbise ne sont pas équipées de radio sol-train, qui
permettent la communication entre le conducteur et le dispatching régional.
Tous les conducteurs et les accompagnateurs disposent désormais
d'un GSM, mais, note un sous-chef de gare, «j'ai l'expérience qu'il n'est
pas toujours possible de contacter les conducteurs par GSM : il n'y a pas de réseau
ou le système informatique qui gère les numéros, Alaska, ne fonctionne
souvent pas.» Ici aussi, une technologie performante existe: le GSM-R. Son
installation serait prévue pour les années à venir. Espérons-le.
Manque de formation
La question de la formation a également été épinglée
lors de l'accident de Pécrot. Les choses ne vont pas en s'améliorant, puisque
la durée de formation a été réduite pour les conducteurs. Quant à leur
formation permanente, un syndicaliste note qu'«elle a été mise de côté
pendant plusieurs années consécutives, par manque de personnel. De plus, les
instructeurs qui accompagnaient régulièrement les conducteurs ont de plus en
plus de tâches administratives, toujours par manque de personnel. Pour ce qui
est du bilinguisme, il n'y a pas de réel programme de formation destiné aux
sous-chefs de gare, pourtant responsables de la sécurité, ni aux conducteurs
et signaleurs.»
Manque de personnel, flexibilité, sous-traitance
Pour faire face à la libéralisation européenne, la
direction SNCB met en oeuvre les plans New Cargo (dans le transport de
marchandises) et New Passengers (transport de voyageurs). D'ici 2005, ces
plans doivent réduire l'effectif de l'entreprise de 40.500 à 38.000. Et
l'objectif de la direction est d'arriver à 32.000 emplois en 2010.
«La suppression de personnel dans les gares de formation,
la multiplication des tâches à effectuer et le déplacement des agents dans
des gares qu'ils connaissent peu va encore détériorer la sécurité,
constate un responsable syndical. De plus, avec la libéralisation du trafic
marchandises (déjà effective sur une partie du réseau), des sociétés
ferroviaires privées font leur apparition et on a déjà pu constater qu'elle
ne respectaient pas les normes de sécurité.»
Un cheminot signale aussi que, dans sa région, certains
sous-chefs des cabines de signalisation accumulent 50 à 100 jours de congés de
retard. Pendant ces grandes vacances, certains ne se sont vu accordé que 13
jours de vacances en continu... Ces agents, qui ont souvent plus de dix ans
d'ancienneté, n'ont jamais vu une situation aussi désastreuse. Elle entraîne
une situation de fatigue aussi néfaste pour les travailleurs que dangereuse sur
le plan de la sécurité.
Le manque de personnel peut prendre des aspects surprenants.
Ainsi, un conducteur remarque que, normalement, des équipes retirent chaque année
les branchages, feuillages et broussailles qui peuvent cacher les panneaux de
signalisation.
«Cette année, cela n'a presque pas été fait. Ces deux
derniers mois, des dizaines de panneaux ne sont plus visibles. Il y a aussi des
branches qui touchent les câbles électriques. Avant, on élaguait les arbres
préventivement. Maintenant, c'est seulement lorsqu'on signale un problème. Et
encore : sur une certaine ligne, j'ai constaté et signalé ces problèmes en
mai et rien n'a été fait jusqu'ici.»
Le même conducteur pointe aussi l'état déplorable des
locomotives, dû au manque de personnel dans les ateliers: «Depuis six mois,
je n'ai pas eu une loco dont je peux dire qu'elle était parfaitement en ordre.»
Verra-t-on bientôt les voyageurs agir comme dans les trains
(privatisés) de Grande-Bretagne: éviter de monter dans les premières
voitures, plus exposées en cas d'accident?
Marco Van Hees
Publié dans Solidaire les 9 et 16 septembre 2004
|